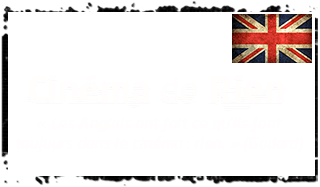Le fameux humour anglais, celui dont on parle souvent comme quelque chose d’indéfinissable, ce je ne sais quoi qui fait toute la différence avec les autres types d’humour. En fait, il faudrait déjà parler plutôt d’humour britannique (les Gallois et les Écossaiscossais sans parler des Irlandais du Nord n’auraient-ils pas d’humour ?) et accepter le fait qu’il y a beaucoup de types d’humour différents au Royaume-Uni qui vont de l’humour de music-hall à l’absurde en passant par la satire et l’usage de l’understatement (euphémisme) et de l’autodérision.
Les Britanniques sont en tout cas les champions quand il s’agit de glisser une touche d’humour un peu partout. Au cinéma comme ailleurs. Il y a souvent des pointes d’humour et un regard satirique dans les oeuvres les plus sérieuses. Un clin d’oeil, un sourire en coin. Et contrairement en France où l’on se prend toujours au sérieux, un intellectuel peut tout à fait signer une comédie, on peut glisser de l’humour dans un drame (qu’il soit social ou psychologique). Ce n’est pas Ken Loach, Mike Leigh ou les cinéastes de la nouvelle vague anglaises qui me contrediront.
Dans le cinéma britannique, la comédie a toujours été un genre central. Mais pendant longtemps on a eu tendance à ne mettre en avant qu’un certain nombre d’entre elles, celles qui plaisaient le plus à la classe moyenne libérale, les satires et les comédies plus « intellectuelles » basées non sur les gags visuels mais sur les dialogues : celles d’Ealing, des frères Boulting ou des Monty Python, ou les adaptations de succès théâtraux, d’Oscar Wilde à Noel Coward. C’est oublier que la comédie est le genre favori des classes populaires qui ont de tout temps porté leurs idoles en tête de box-office, et ce depuis l’époque du muet.
L’humour populaire (« low humour ») est un humour incarné en Grande-Bretagne depuis le milieu du XIXe siècle par les artistes de music-hall qui s’expriment sur scène à travers des numéros basés sur les gags visuels, des chansons… En Angleterre, c’est la première forme de divertissement dans les villes de plus en plus peuplées, suite à la révolution industrielle. Après une dure journée de labeur, l’ouvrier peut s’échapper de sa vie quotidienne à travers le rire. Celui-ci déforme le quotidien, grossit les traits, provoque les figures d’autorité, les institutions et le système de classe sans le remettre en cause fondamentalement. C’est un rire exutoire où le spectateur peut se défouler et se débarrasser de ses frustrations. C’est rarement un rire révolutionnaire et les élites intellectuelles lui reprochent souvent sa légèreté et son manque de consistance.
UN CINÉMA QUI NAÎT SOUS LE SIGNE DE LA COMÉDIE

Le premier film britannique (ou en tout cas l’un des tout premiers – il y a débat !) sera donc une comédie, ou plutôt un gag filmé, « The Soldier’s Courtship », tourné en 1896 par R.W. Paul. Déjà un embryon de comédie romantique pourrait-on dire, dans lequel un soldat embrasse une jeune femme sur un banc avant d’être gêné par une vieille femme qui insiste à vouloir partager le même banc qu’eux. Le soldat essaiera de lui faire comprendre qu’elle n’est pas la bienvenue avant de devoir employer la manière forte pour se débarrasser de l’intrus !
Globalement les producteurs britanniques produisent beaucoup de comédies où le personnage central se retrouve dans une situation d’embarras, que ce soit à cause de sa position sociale ou de ses pulsions sexuelles. Ou des figures d’autorité se retrouvent dans des situations ridicules. Les courses poursuites comiques sont également très appréciées.
Quand la technique permettra de faire des films plus longs avec une narration (notamment grâce aux intertitres), on adaptera alors Oscar Wilde, Noël Coward ou encore H.G. Wells (ce dernier n’étant pas qu’un écrivain de SF) ou encore les comédies de Shakespeare.
Avant même la Première Guerre mondiale, la concurrence américaine se fait de plus en plus sentir et pour se démarquer, les producteurs britanniques commencent à mettre en avant les spécificités britanniques et le système de classe devient alors un élément comique majeur.
Pour faire carrière, plusieurs comiques anglais décident de parier sur le Nouveau Monde. Deux des plus grands acteurs muets du cinéma américain quittent ainsi leur Angleterre natale en 1913 : Stan Laurel et Charlie Chaplin. Ils feront tous les deux la quasi-intégralité de leur carrière outre-Atlantique. Chaplin ne reviendra qu’en Angleterre que suite à la chasse aux sorcières anticommuniste du Maccarthysme et y tournera ses deux derniers films dont sa satire « A King in New York » (1957).
Dans les années 20, on adapte les écrivains populaires de l’époque. La comédie romantique (avec notamment Manning Hayes), la satire (Adrian Brunel, Ivor Montagu). De futurs réalisateurs importants comme Alfred Hitchcock et Anthony Asquith débutent par la comédie. Si Hitchcock décide non sans raison qu’il n’est pas fait pour la comédie et fera prendre à sa carrière un virage quelque peu différent, Asquith reste fidèle au genre et on lui doit certaines des meilleures comédies britanniques dont « Pygmalion » (1938) ou une excellente adaptation d’Oscar Wilde « The Importance of Being Earnest » (1952).
LES PREMIERES STARS COMIQUES DU PARLANT
L’arrivée du son en 1928 ouvre de nouvelles possibilités mais renforce encore l’influence américaine qui voit dans la Grande-Bretagne le premier marché d’importation pour son cinéma.

Les comiques britanniques populaires viennent alors principalement du Nord et sont formés au Music Hall, comme Gracie Fields, Will Hay et George Formby. Les numéros chantés sont souvent de la partie et loin du glamour hollywoodien, la comédie britannique s’intéresse aux petites gens dont les comiques sont les hérauts.
Actrice et chanteuse déjà rompue à la scène, Gracie Fields (1898-1979) fait des débuts triomphants au cinéma dans la comédie romantique « Sally in Our Alley » en 1931. Elle continuera avec des comédies musicales et romantiques, incarnant à la perfection une représentante des classes populaire, fort et optimiste. Elle tournera notamment sous la direction de Basil Dean, ira tourner aux États-Unis pendant la guerre, pour prendre sa retraite cinématographique en 1945.
Will Hay (1888-1949) triomphe dans son rôle de proviseur dépassé d’une école publique dans « Boys Will Be Boys » (1935) à l’âge de 47 ans après une carrière fulgurante dans le music-hall qui lui a valu notamment de jouer devant le couple royal. Il tournera dans encore une dizaine de films (dont le classique « Oh, Mr Porter » en 1937) avant de prendre sa retraite en 1943 suite à des problèmes de santé qui l’emporteront six ans plus tard.
George Formby (1904-1961) est un fils de la balle. Il reprend d’ailleurs les numéros, les chansons et le nom de scène de son père. Il joue les imbéciles heureux, aussi idiot que jovial et ambitieux. Sa carrière prend un tournant inattendu quand il fait l’acquisition d’un ukulélé. Il débute à l’écran en 1934 dans « Boots! Boots! ». Il tournera dans une dizaine de films jusqu’en 1946.
Le premier grand succès international du cinéma britannique sera également une comédie. Il s’agit de « The Private Life of Henry VIII » (1937), réalisé par un immigré hongrois, Alexander Korda. Charles Laughton y joue un Henry VIII plus vrai que nature et sa prestation tragi-comique lui vaudra un Oscar. Korda, qui deviendra décidément un parfait citoyen britannique, produira un certain nombre de comédies de tout genre : la comédie fantastique écrite par HG Wells « The Man who Could Work Miracles » (1936), la comédie romantique (« The Divorce of Lady X », 1938) ou l’adaptation inévitable d’une pièce d’Oscar Wilde « An Ideal Husband » (1947).
PENDANT LA GUERRE

Dans les années 40, l’humour distingué et spirituel de Noel Coward est adapté sur grand écran par David Lean dans « The Happy Breed » (Heureux mortels, 1944) et « Blithe Spirit » (L’esprit s’amuse, 1945).
Côté humour populaire, le natif de Liverpool, Arthur Askey (1900-82), imitateur de talent, commence au music-hall mais devient une star à la fin des années 30 grâce à une série radio de la BBC. Ce succès lui vaudra de tourner plusieurs comédies pour Gainsborough Pictures pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans l’adaptation de sa série radio « Band Wagon » (1940).
Frank Randle (1901-1957), originaire du Lancashire comme Fields et Formby est un cas à part. Alors que la plupart des comiques tentent de développer un personnage aimable par le public, Randle construit un personnage à son image, beaucoup plus subversif et violent face à toute forme d’autorité. Un homme difficile, alcoolique et parfois violent (il avait régulièrement des problèmes avec la police), il est célèbre pour s’être fait arracher les dents afin de développer son jeu de grimaces et jetait régulièrement son dentier dans le public pendant ses spectacles ! Au cinéma il jouera dans dix films dont la fameuse série « Somewhere… » (4 films entre 1940 et 43 dont « Somewhere in Camp« ) produits par Mancunian Films, une maison de production de Manchester qui produisait essentiellement des comédies à très petit budget destinées au public du nord de l’Angleterre. C’est eux qui ont également découvert George Formby.
L’APRÈS-GUERRE, L’AGE D’OR
L’après-guerre est une période de grand changement. L’Angleterre sort victorieuse de la guerre mais à quel prix. Le rationnement durera jusqu’en 1954, son empire s’effondre (son joyau, l’Inde, gagne l’indépendance en 1947,…). D’un autre côté, la population profite d’avancées sociales menées par le désir de construire un monde nouveau (le NHS inaugure la santé gratuite pour tous en 1948),…

De 1947 à 1957, Ealing va sortir une série de 18 comédies qui vont devenir des institutions. Bien que moins homogènes qu’on veut parfois s’en souvenir, les comédies Ealing de cette époque mettent en avant la solidarité d’une petite communauté traditionnelle face à un danger extérieur (« Whisky Galore » en 1949, « The Titfield Thunderbolt » en 1953). Non que l’individualisme anglais ne revienne pas parfois au galop (« The Man in the White Suit », 1951).
La comédie criminelle est un genre très actif de l’après-guerre notamment chez Ealing bien sûr (« Kind Hearts and Coronets » en 1949, « The Lavender Hill Mob » en 1951 et « The Ladykillers » en 1955). Ou avec « Father Brown » (1954) et, semi-parodie du thriller d’espionnage, « Our Man in Havana » (1959). Tous ces films ont pour acteur principal Alec Guinness (1914-2000), acteur venu du théâtre classique et qui est une figure majeure de la comédie britannique de l’après-guerre grâce au triomphe de la comédie dégoulinant d’humour noir « Kind Hearts and Coronets » où il tient pas moins de huit rôles !
Les frères Roy et John Boulting vont produire à la fin des années 50 une série de comédies avec le gratin des comiques anglais : Ian Camrichael, Therry-Thomas ou encore Peter Sellers. Qu’ils se moquent des relations patronat-syndicat dans « I’m All Right Jack » (1959), de l’Empire britannique déliquescent dans « Carlton-Brown of the FO » (1959) ou de la religion dans « Heaven’s Above! » (1963), leur humour fait mouche.
Non que les Boulting soient d’ailleurs les seuls à jouer la carte de la satire. À l’époque un autre duo formé par Sidney Gilliat et Frank Launder écrivent, réalisent et produisent des comédies avec une touche satirique avec « Lady Godiva Rides Again » (1951) sur les concours de beauté et la gloire sans lendemain, « Green Man » (1956) sur un assassin professionnel qui a du mal à assassiner un ministre, « Left, Right and Center » (1959) sur un candidat conservateur qui tombe amoureux d’une candidate travailliste en pleine campagne pour les élections ou la série des Saint Trinian’s sur une école publique pas tout à fait comme les autres (à partir de 1954) .
DES FILMS EN SÉRIE

Dans les années 50, les institutions qui créent un patrimoine d’expériences communes deviennent des lieux de comédies populaires, que ce soit le service militaire, l’école ou l’hôpital. Plusieurs de ces films vont triompher sur les écrans britanniques pendant les années 50, donnant lieu à des séries de films. La comédie hospitalière « Doctor in the House » (1954) de Ralph Thomas avec Dirk Bogarde sera suivie de six suites. « The Belles of St. Trinian’s » (1954 également) met en scène de jeunes écolières dévergondées et connaîtra quatre suites.
Quant à « Carry On Sergent » (1958), comédie légère sur le service militaire, elle inaugure une série de 31 films, quasiment tous réalisés par Gerarld Thomas (le frère de Ralph cité plus haut) et produits par Peter Rodgers, avec des acteurs récurrents, qui durera jusqu’en 1978 (bon 1992 si on compte le dernier opus sorti après 14 ans de silence) ! Les films des « Carry On », produits à petit budget pour le public britannique (sans grand espoir d’exportation), proposent un humour bon enfant, gentiment satirique, qui mettent en scène des représentants des classes populaires et moyennes à travers un humour inspiré du music-hall. Évidemment en 30 ans la recette va évoluer, et les « Carry On » vont faire aussi bien dans la critique (peu virulente) des institutions, la mise en scène de différentes professions et de faits de société ou encore la parodie de films.
 Bien qu’inconnu en France, Norman Wisdom (1915-2010) est l’un des comiques les plus populaires du cinéma britannique. Ce londonien qui a vécu une jeunesse marquée par la pauvreté et la violence paternelle, sera d’abord une star du music hall. Il a perfectionné pendant des années son personnage du « Gump », un grand enfant qui a quelques difficultés avec les normes sociales. Capable de pitreries physiques qui n’ont rien à envier aux grands noms de la comédie (on l’a souvent comparé un peu rapidement à Jerry Lewis), et doté d’un joli filet de voix, il porte son premier film en tant que tête d’affiche en 1953 avec « Trouble in Store » et le triomphe est immédiat. Sous contrat avec le studio Rank, il enchaîne les comédies à succès jusqu’au milieu des années 60. Un rendez-vous raté avec les USA va mettre quasiment un terme à sa carrière cinéma, mais il reste le plus bel exemple de réussite de portage d’un artiste de music-hall vers le 7e art.
Bien qu’inconnu en France, Norman Wisdom (1915-2010) est l’un des comiques les plus populaires du cinéma britannique. Ce londonien qui a vécu une jeunesse marquée par la pauvreté et la violence paternelle, sera d’abord une star du music hall. Il a perfectionné pendant des années son personnage du « Gump », un grand enfant qui a quelques difficultés avec les normes sociales. Capable de pitreries physiques qui n’ont rien à envier aux grands noms de la comédie (on l’a souvent comparé un peu rapidement à Jerry Lewis), et doté d’un joli filet de voix, il porte son premier film en tant que tête d’affiche en 1953 avec « Trouble in Store » et le triomphe est immédiat. Sous contrat avec le studio Rank, il enchaîne les comédies à succès jusqu’au milieu des années 60. Un rendez-vous raté avec les USA va mettre quasiment un terme à sa carrière cinéma, mais il reste le plus bel exemple de réussite de portage d’un artiste de music-hall vers le 7e art.
A la fin des années 50, la nouvelle vague anglaise remet les classes populaires sur l’écran avec une volonté de réalisme. Mais la comédie n’est pas ignorée par les jeunes-turcs du cinéma britannique. John Schlesinger signe le portrait d’un jeune rêveur dans « Billy Liar » (1964), Karel Reisz d’un artiste fou à lier dans « Morgan » (1966), Tony Richardson d’un coureur de jupons dans la comédie historique oscarisée « Tom Jones » (1963). Quant à Lindsay Anderson, il signera plus tard deux satires outrancières à la limite du fantastique « O Lucky Man » (1973) et « Britania Hospital » (1982).
ANNÉES SOIXANTE, LE TEMPS DE LA LIBERTÉ
Les années 60 commencent de manière sagement excentrique à l’image de Miss Marple, l’héroïne d’Agatha Christie qui se voit porter à l’écran dans une série de films où elle est interprétée par Margaret Rutherford (1892-1972) à partir de 1961 (« Murder she Said »). Rutherford s’est fait une spécialité de jouer depuis une dizaine d’années les femmes excentriques, rôles dans lesquels elle excelle.

Rapidement, les années 60 effacent le reliquat des années 50 et la suite est marquée par une légèreté et un dynamisme né du swinging London. Les Beatles triomphent et délirent sur grand écran avec « Help » (1965) de Richard Lester, un vent d’optimisme submerge la Grande-Bretagne. Les restrictions de l’immédiat après guerre s’éloignent, la jeunesse veut s’amuser et profiter d’une liberté grandissante !
Au-delà de ses deux films pour les Beatles, Richard Lester, un Américain installé en Angleterre, signera LA comédie du swinging London, « The Knack… and How to Get it » (1965). Quelques années plus tard, il réalisera une comédie absurde située dans une Angleterre post apocalyptique qui vaut son pesant de cacahuètes « The Bed Sitting Room » (L’ultime garçonnière, 1969) basé sur une pièce de Spike Milligan.
Autre comédie symbole de cette époque « Alfie » (1966) de Lewis Gilbert avec Michael Caine en Casanova des temps modernes. Il reste que même dans ces comédies, légères sur le papier, une certaine forme de gravité subsiste. Ainsi la scène d’avortement dans « Afie ». La comédie prend parfois un goût amer, et la jeunesse de l’époque, trop libertaire (?) n’est pas épargnée par le cinéma qui souligne les dangers de ces excès.
La star britannique incontournable des années 60 est Peter Sellers (1925-1980). Venu de la radio où il faisait partie du trio mythique « The Goons » (1951-60) avec Spike Milligan et Harry Secombe, il commence en parallèle une carrière d’acteur au cinéma. On l’a vu dans les années 50 dans la comédie noire de chez Ealing « The Ladykillers » (1955) puis chez les frères Boulting (« Carlton Browne of the FO » et « I’m all Right Jack » en 1959). Il tourne alors beaucoup. Mais c’est le triomphe de « The Pink Panther » en 1963 qui va lui donner un statut de star internationale.
Le milieu des années 60 est marqué par le boom satirique porté par Peter Cook (1937-1995) et Dudley Moore (1935-2002). Mais le duo, célèbre de la scène jusqu’à la télévision n’aura droit qu’à que quelques rares incursions sur grand écran dans le plutôt réussi « Bedazzled » (Fantasmes, 1967) ou une parodie (ratée) de « The Hound of the Baskervilles » (1978). Si Dudley ira chercher le succès à Hollywood (« 10 » en 1979 et « Arthur » en 1981), on continuera à voir occasionnellement Cook au cinéma, notamment dans les satires politiques, un genre par ailleurs peu présent sur grand écran, « The Rise and Rise of Michael Rimmer » (1970) et « Whoops Apocalypse » (1986).
À la toute fin des années 70, Moore et Cook se réuniront une dernière fois pour une session d’enregistrement d’un nouveau 33 tours où ils incarnent leurs deux alter-ego trash devenus cultes, Derek et Clive. La session est filmée par un jeune réalisateur australien Russell Mulcahy (qui tournera sept ans plus tard un certain « Highlander »). Le résultat, « Derek and Clive Get the Horn » (1979) était tellement provocant et malsain (Moore et Cook pouvaient alors à peine se supporter) que le film sera interdit de sortie en salles au Royaume-Uni ! Il faudra attendre le début des années 90 pour que le film apparaisse enfin… en VHS.