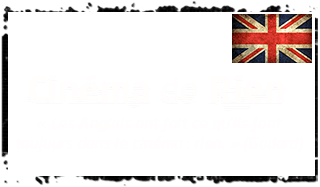De 1956 à 59, le Free Cinema propose une relecture poétique du quotidien des classes populaires. Une véritable petite révolution

Walter Lassally et Karel Reisz sur le tournage de « We are the Lambeth boys » (1959). Photo (c) BFI.
Dans le livret publié dans le coffret « Free Cinema » sorti à l’occasion des 50 ans du Free Cinema, Christophe Dupin pouvait écrire que le mouvement était « hautement influent » dans l’histoire du cinéma britannique mais restait « négligé par la critique ».
En France, peu de gens connaissent la nouvelle vague anglaise, encore moins le Free Cinema. Pourtant, au-delà de la Grande-Bretagne, ce mouvement, ses racines (le mouvement documentaire britannique) et ses fruits (la nouvelle vague anglaise, elle-même comprise dans le mouvement artistique du kitchen sink realism, et ses ramifications dans le cinéma actuel) ne peuvent être ignorés.
Mais de quoi parle-t-on au juste ? Le Free Cinema fait référence à six programmes composés essentiellement (mais pas seulement) de courts documentaires, et montrés au National Film Theatre (NFT) entre février 1956 et mars 1959.
La programmation a été mise au point par un groupe de jeunes cinéastes et critiques (Lindsay Anderson, Tony Richardson, Karel Reisz et Lorenza Mazetti pour la première édition). Il y eu six événements en tout. Trois ont été consacrés au cinéma britannique et trois au cinéma international. Même si les fondateurs du Free Cinema reconnaissaient des âmes sœurs dans d’autres pays (notamment la France avec Franju, Truffaut et Chabrol), le terme « Free Cinema » est aujourd’hui appliqué aux seuls documentaires britanniques de la programmation.
La création du Free Cinema a été motivée par l’impossibilité pour ce petit groupe de montrer leurs réalisations. Lindsay Anderson a alors eu l’idée de créer un « mouvement » afin de donner une cohésion à leur travail, et de pouvoir organiser des projections communes. Karel Reisz s’occupant à l’époque de la programmation du NFT, ils ont réussi à obtenir la salle pour 4 jours, entre le 5 et le 8 février 1956.
Comme le reconnaîtra Anderson lui-même à de nombreuses reprises, et notamment ici en 1971 dans une interview accordée au critique Alexander Walker (dans « Hollywood England »)
Le Free Cinema n’était rien d’autre qu’un label de commodité. Il n’avait d’autre but que de montrer notre travail. C’était pragmatique et opportuniste… Sans ce titre déclamatoire, je pense sincèrement que la presse ne nous aurait pas accordé la moindre attention.
Ce premier événement, qui était censé être unique, regroupe trois films, dont deux documentaires, au ton bien différent. « O dreamland » pose un regard sardonique sur les fêtes foraines (et le divertissement populaire) alors que « Momma don’t allow » propose un regard complice sur une soirée dans un club de jazz où les jeunes de tout milieu se retrouvent en fin de journée, effaçant l’espace de quelques heures les différences sociales. Dernière oeuvre du programme, « Together » est une fiction au ton poétique (le quotidien tragique de deux sourds muets dans les quartiers populaires de Londres).
Mais malgré leur disparité apparente, ces oeuvres ont des points communs évidents. Elles proposent un regard très personnel sur le quotidien des classes populaires, et mêlent réalisme et point de vue subjectif pour aboutir in fine à une certaine forme de poésie du quotidien (on voit l’influence indéniable des documentaristes John Grierson et Humphrey Jennings). Techniquement, elles ont été tournées en noir et blanc, avec un équipement très léger (caméra Bolex 16 mm pour les deux documentaires, caméra 35 mm pour « Together » et un enregistreur à cassette pour le son) qui force aux plans courts – 22 secondes max pour la Bolex – et à un usage du son créatif – avec un recours minimum ou inexistant aux dialogues. Ces oeuvres ont été réalisées avec l’aide de techniciens bénévoles (le caméraman Walter Lassally et le monteur/ingénieur du son John Fletcher resteront fidèles au mouvement jusqu’au bout), et ont été soit auto-financées (« O dreamland ») ou très chichement sponsorisés par le BFI Experimental Film Fund (pour les deux autres).
Le manifeste du Free cinema a été publié en février 1956, et est signé Lorenza Mazetti, Lindsay Anderson, Karel Reisz et Tony Richardson.
Ces films n’ont pas été tournés ensemble : ni même dans l’idée de les montrer ensemble. Mais quand ils ont été achevés, nous avons trouvé qu’ils avaient des attitudes en commun. Implicitement, leur attitude partageait une croyance dans la liberté, dans l’importance des gens et dans la signification du quotidien.
En tant que cinéastes, nous croyons que :
Un film ne peut être trop personnel.
L’image parle. Le son amplifie et commente.
La taille est sans importance. La perfection n’est pas un but.Une attitude signifie un style. Un style signifie une attitude.
Pour Tony Richardson, il s’agissait de « rappeler les principes basiques du cinéma sans aucune théorie révolutionnaire » (in « Hollywood England »).
Cette première édition de « Free Cinema », qui n’avait donc pas vocation à se répéter, a rencontré un important succès public et critique. Plus de 6.000 personnes ont assisté aux projections, sous le regard de la presse mais aussi des réalisateurs bien installés : les frères Boulting, Carol Reed ou encore Henry Cornelius ont fait le déplacement.
Dès septembre 56, Free Cinema revient avec une édition consacrée aux réalisateurs étrangers. Puis du 25 au 28 mai 1957 a lieu la 3e édition : « Free Cinema 3 : Look at Britain ! ».
Dans leur manifeste, le « Comité pour le Free Cinema » rappelle que :
Nous vous demandons de nous percevoir non comme des critiques, ni comme une diversion, mais de nous considérer en relation directe avec un cinéma Britannique toujours obstinément rigidifié par la division des classes sociales; rejetant toujours les stimuli de la vie contemporaine, et déclinant la responsabilité de critiquer; reflétant toujours une culture anglaise sudiste et métropolitaine qui exclut la riche diversité de traditions et de personnalités qui forment la Grande-Bretagne.
Lindsay Anderson est au coeur de cette édition avec un documentaire réalisé quelques années plus tôt (« Wakefield Express », documentaire sur un journal de province datant de 1952) et surtout « Everyday except Christmas », la production la plus ambitieuse produite jusqu’alors dans le cadre du Free Cinema. « Everyday… » a pu voir le jour grâce au soutien de Ford Motors (Karel Reisz avait accepté de travailler au département publicité de Ford en échange de leur soutien financier pour des productions du Free Cinema !). Quatre semaines de tournage ont été nécessaires pour ce documentaire de 39 mn sur le travail de nuit et de jour au marché de Convent Garden. Le documentaire recevra le grand Prix du Festival de Venise des courts et documentaires. Cette 3e édition ouvre ses portes également à un collectif d’Edinburgh (« The Singing Street » sur les jeux et chants d’enfants de 12 à 13 ans à travers les rues d’Edinburgh) et à deux jeunes Suisses Claude Goretta et Alain Tanner qui travaillaient alors pour le BFI et ont voulu créer une oeuvre dans le style du Free Cinema : « Nice time » est un documentaire enthousiaste et caméra au poing sur un samedi soir typique à Picadilly Circus.
Après deux autres éditions consacrées aux réalisations étrangères, le Free Cinema revient une dernière fois au NFT en mars 1959. Le manifeste qui annonce la fin du Free Cinema est signé par Lindsay Anderson, John Fletcher, Walter Lassly et Karel Reisz. Ce manifeste se veut optimiste, soulignant les récompenses reçues par les films du Free Cinema, les nombreuses projections à l’international et l’arrivée de nouveaux types de films et d’une nouvelle génération de cinéastes. Mais pour eux il est temps de tourner la page.
Le public a été très nombreux et enthousiaste. Et, en grande partie pour cette raison, (le free cinema) est devenu un mouvement. À présent, voici le sixième de ces programmes et le dernier. (…)L’effort demandé pour faire ces films de cette façon, en dehors du système, est énorme, et ne peut être poursuivi indéfiniment (…). En faisant ces films, et présentant ces programmes, nous avons essayé de prendre parti pour un cinéma créatif et indépendant dans un monde où les pressions du conformisme et du commercial sont de plus en plus fort chaque jour. Nous n’abandonnerons pas ces convictions, ni n’arrêterons de tenter de les mettre en pratique. Mais nous pressentons que ce mouvement a rempli sa mission. Une autre année serait passée, et le Free Cinema lui-même aurait pu devenir un simple catalogue. Nous préférons arrêter en haut de la vague.
Cette édition introduit Robert Vas (« Refugee England » un docu fiction sur un réfugié hongrois qui débarque à Londres), Elizabeth Russell (« Food For a Blush », une fiction surréaliste) et Unit Five Seven, un collectif de jeunes techniciens travaillant à Manchester pour Granada Télévision et mené par un certain Michael Grigsby (« Enginemen », un documentaire sur les conducteurs de locomotive). Enfin « We are the Lambeth Boys » de Karel Reisz propose un regard attendri sur un club de jeunes dans le sud de Londres (loin de la jeunesse violente incarnée à l’époque par les « teddy boys »). Ce regard subjectif en fait plus un essai filmé qu’un documentaire pour reprendre les mots du sociologue Richard Hoggart : « la faiblesse ici – et la faiblesse la plus courante dans le Free Cinema – est sa tendance à l’idéalisation ».
Pour autant, et même si certains estiment également que les documentaires et les fictions à la télévision britannique ont connu au début des années 60 un bouleversement semblable, et ont eu un impact bien plus fort (grâce à la portée incomparable du media en question), le Free Cinema garde une valeur symbolique très importante. Moins intellectualisé que d’autres mouvements culturels (mais c’est assez propre au cinéma anglais qu’on peut difficilement qualifier de prétentieux – d’ailleurs dans son livre « Hollywood England », Alexandre Walker intitule le passage de son livre consacré au Free Cinema « No theory please, we’re British »), le Free Cinema a eu un impact très important sur l’évolution du cinéma britannique qu’on peut percevoir encore aujourd’hui à travers une bonne partie de la production où le réalisme social constitue un aspect primordial, presque un différenciateur national quel que soit le genre (horreur, comédie, drame, thriller,…).
Alors que le Free Cinema ferme ses portes définitivement, Tony Richardson, qui était le plus expérimenté de l’équipe (il réalisait et produisait des documentaires et téléfilms pour la BBC depuis 1952), monte sa propre société de production (Woodfall films) et tourne « Look Back in Anger » (1959) qui va marquer les débuts de la nouvelle vague anglaise. Karel Reisz va également bientôt se lancer avec « Saturday Night and Sunday Morning » (1960). Le dernier à tourner un long sera Lindsay Anderson avec « This Sporting Life » (1962). Trois chefs d’oeuvre de réalisme social marqués par l’influence du Free Cinema.
Le manifeste de la 6e édition apporte le mot de la fin :
Le Free Cinema est mort, longue vie au Free Cinema !
A noter que grâce aux éditions Doriane Films, le coffret « Free Cinema » du BFI, qui regroupe toutes les oeuvres citées plus une sélection d’oeuvres proches du free cinema et le documentaire « Small is beautiful », est disponible avec des sous titres français. A posséder absolument (malgré une qualité d’image aléatoire – il est étonnant que le BFI n’est pas fait un effort conséquent de rénovation pour des documents d’une telle importance) !
(Cet article doit beaucoup au formidable livret de Christophe Dupin compris dans le coffret du BFI)
Free Cinema 1 – 5 au 8 Février 1956
O Dreamland (1953) de Lindsay Anderson (12 mn)
Momma don’t allow (1956) de Karel reisz et Tony Richardson (22 mn)
Together (1956) de Lorenza Mazzetti, assisté de Denis Horn (49 mn)
Free Cinema 3 – Look at Britain – 25 au 28 Mai 1957
Wakefield express (1952) de Lindsay Anderson (30 mn)
Nice Time (1957) de Claude Goretta et Alain Tanner (17 mn)
The Singing street (1952) de N McIsaac, JTR Ritchie et R Townsend (30 mn)
Everyday except christmas (1957) de Lindsay Anderson (39 mn)
Free Cinema 6 – The Last Free Cinema – 18 au 22 Mars 1959
Refuge England (1959) de Robert Vas (27 mn)
Enginemen (1959) de Michael Grisby (17 mn)
We are the Lambeth boys (1959) de Karel Reisz (49 mn)
Food for a blush (1959) d’Elizabeth Russell (30 mn)